Latour et détours
Bruno Latour, « le plus célèbre et le plus incompris des philosophes français » (New York Times, 2018) est décédé le 9 octobre dernier à l’âge de 75 ans. Philosophe, certes, (« je suis un philosophe du sens commun »)mais pas seulement. Touche-à-tout dans les domaines du savoir, il aura notamment exploré les champs de l’écologie, du droit, de l’anthropologie, de la religion et des sciences et techniques. « Sociologue iconoclaste » comme le souligne Nicolas Truonc (1), Latour n’aura eu de cesse de penser le régime climatique dans lequel nous vivons désormais. Et aura influencé nombre de nouveaux « penseurs du vivant », à l’instar de Baptiste Morizet et de Richard Powers (2). Voire même des chefs étoilés, tel Olivier Roellinger. Petit clin d’œil pour nous, il est d’usage de brocarder ses fidèles en les rassemblant au sein d’un « Latourisme club » qui, selon ses détracteurs, composerait un groupe informel de connivence au sein de certains réseaux de pouvoir.
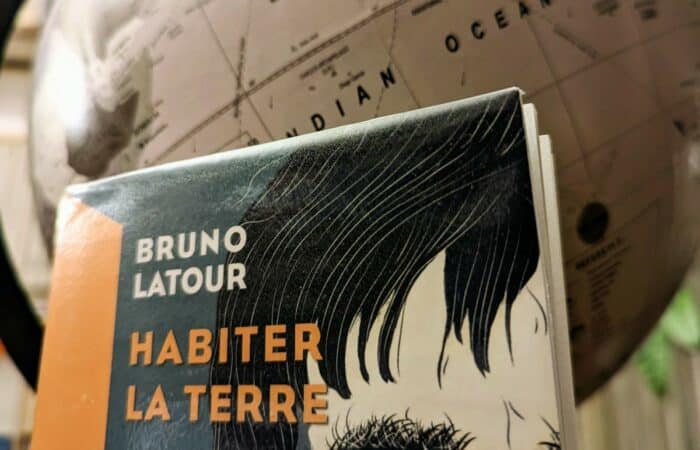
La fin de la modernité
« Nous n’avons jamais été modernes » est le titre de l’un de sa trentaine d’ouvrages parus. Il y remet en cause la distinction entre culture et nature, objets et sujets, humains et non-humains ; ce postulat défendu par ce qu’il nomme « les modernes », c’est-à-dire le courant de pensée qui prédominait selon lui jusqu’à ce que nous soyons entrés dans l’ère de l’anthropocène et la reconnaissance que « ce sont les vivants qui fabriquent leurs propres conditions d’existence. » (3) Pour Bruno Latour, conviction ultime, ce clivage socialement construit doit être dépassé au profit d’un nouveau mode d’interaction politique. Car cette séparation entre ce qui relève de la nature, qui incomberait aux scientifiques, et ce qui touche à la société, qui serait du ressort des politiques est improductive, pire, illégitime. Il évoque ces objets « hybrides » que seul l’usage conjoint des sciences sociales et celles de la nature permet d’appréhender. Il utilisera cette mixité pour tenter de construire un « gouvernement de la nature. »
Il en viendra jusqu’à imaginer un « parlement des choses » afin qu’un dialogue s’établisse entre des représentants des humains et ceux des « non-humains associés. » Portée en région Centre – Val de Loire par le Polau (pour pôle «arts et urbanisme»), c’est précisément sous cette influence que le « Parlement de Loire » a vu le jour avec pour objectif la prise en compte des intérêts de cette entité « non humaine » qu’est un fleuve. Des auditions publiques ont ainsi été menées auprès des habitants et des personnalités visant à en faire reconnaître la personnalité.
Bruno Latour a donc reconsidéré les sciences sociales, privilégiant l’interaction, combinant les approches, réfutant les postures idéologiques. La sociologie comme science des associations plus que du social. Il affirmait qu’un fait n’est jamais pur mais qu’il résulte d’une « négociation sociale. » Ainsi « le trou dans la couche d’ozone qui est autant naturel que social, politique, économique. » (4) Il a donc mis en lumière l’hybride. Révélation que reprendront d’autres intellectuels. Comme Gabrielle Halpern (5) qui évoquera l’image du centaure pour illustrer l’hybride, le grand refoulé de l’histoire de la pensée occidentale.
Nous n’habitons plus la même terre
Et si finalement le confinement avait été la répétition générale du « monde d’après » ? Ce monde d’après qui résonne comme une incantation, à défaut d’un projet mobilisateur. Le confinement serait ainsi le révélateur d’une situation écologique que chacun d’entre nous percevait sans pour autant l’admettre ? Jusqu’à ce que l’on fasse l’amère expérience corporelle, reclus dans nos appartements ou nos maisons, permettant par là même d’éprouver son interdépendance avec le vivant. S’ouvre alors la sidérante révélation que notre espace de vie s’est rétréci, au propre comme au figuré.
Jusqu’au XXe siècle, ébloui par la révolution galiléenne, le monde était considéré comme « une Terre dans le cosmos infini ». Mais force est de constater que nous vivons sur une mince couche terrestre de quelques kilomètres seulement d’épaisseur que Latour nomme Gaïa, la « Déesse mère. » Nous nous pensions libres et autonomes dans cet univers par essence infini alors que nous nous retrouvons dépendants d’une si fragile biosphère. Quelle détresse que celle de ressentir cette impression de limite. Au XIXe siècle, Xavier de Maistre et son « Voyage autour de ma chambre » en avait déjà éprouvé la sensation. Autre forme de confinement, celui d’un jeune officier mis aux arrêts à la suite d’une affaire de duel. Et cette réflexion, tellement d’actualité : « Malheur à celui qui ne peut être seul un jour de sa vie sans éprouver le tourment de l’ennui, et qui préfère, s’il le faut, converser avec des sots plutôt qu’avec lui-même !” Description prémonitoire des réseaux sociaux ? Mais on est désormais bien loin de cette odyssée du huis-clos. Aujourd’hui, c’est sauve-qui-peut ! « L’horizon indépassable de notre temps » cher à Jean-Paul Sartre est désormais celui de « l’habitabilité », plus que celui de l’économie. Et donc cette question posée par Bruno Latour : « Où atterrir ? » (6) Car pour tout réinventer, puisque nous vivons hors-sol (« La globalisation nous a mené hors-sol »), il est impératif de revenir sur terre.
Vers une nouvelle lutte des classes
Il nous appartient donc de nous départir de nous-mêmes, d’abandonner les schémas de pensée habituels. Condition indispensable pour saisir ce que nous disent ces exceptionnels bouleversements qui fondent désormais notre quotidien.
Dans l’Histoire, on n’a jamais vu un État s’emparer de problèmes et mettre en place des solutions qui n’ont pas d’abord été portées par la société civile remarque Bruno Latour. Il ne peut donc pas en être autrement concernant la question écologique. Faut-il alors continuer de croire dans le rôle de l’État pour résoudre ce problème sociétal ? Pour Latour, la société en tant que telle n’existe pas, elle ne doit pas être considérée comme chose acquise. Le social serait donc « l’association nouvelle entre des êtres surprenants qui viennent briser la certitude confortable d’appartenir au même monde commun ».
Puisque « le nouveau régime climatique est bel et bien un nouveau régime politique », que valent encore ces vieilles représentations que seraient la souveraineté, l’État-nation voire même la notion de frontière ? « Plus rien ne tient dans l’état national maintenant. Pas plus les virus que le climat qui nous bouleversent tous. Par contrecoup en quelque sorte, le territoire au sens de la localité n’a plus de sens non plus. Rien n’est plus national mais rien n’est non plus local. Il y a donc une sorte de perturbation générale. »
Et pour accentuer davantage sa démonstration, Bruno Latour appelle de ses vœux la constitution d’une nouvelle classe sociale qu’il nomme « géo-sociale. » Car « l’écologie c’est la nouvelle lutte des classes ». Exit celle opposant bourgeoisie et prolétariat. Désormais s’affronteraient les « extracteurs » qui opposent un déni à la crise climatique, et les « ravaudeurs », rapiéçant au prix de multiples initiatives un monde menacé et détérioré.
Pour autant, Bruno Latour ne prônait pas la décroissance car « apportant trop de confusion et tuant la pensée écologique. » Et l’habitabilité ne doit pas conduire à renoncer à la prospérité au motif que « le vivant ne cesse d’inventer et de contourner ses limites. »
En bande organisée
Sa méthode de prédilection ? L’enquête.
C’est ainsi qu’après la crise des gilets jaunes, Latour a lancé une série « d’ateliers collectifs d’autodescription », formulation par différents métiers et professions de leurs conditions d’existence dans cette France d’en bas, au cœur de cette diagonale du vide qui a soudain donné voix. Comme il y a un peu plus de deux cents ans. D’où l’idée de ces nouveaux cahiers de doléances.
Entre la fuite hors-sol et le retour à l’état national, il y a pour Latour autre chose qui exige une nouvelle définition du territoire. Le confinement a démontré que nos sociétés ont des capacités de changement insoupçonnées. Mais encore faudrait-il que les citoyens sachent ce qu’ils veulent changer. Il formule alors cette question centrale : « De qui vous dépendez pour exister ? » Car pour faire de la politique, il faut définir ce à quoi l’on tient.
C’est donc en milieu rural que cette expérimentation s’est déployée, s’appuyant sur des groupes de volontaires qui, une année durant et à intervalles réguliers, se sont retrouvés au cours de séances codifiées.
Et après ?
Dans « Où suis-je ? » (7), Bruno Latour fait référence à Franz Kafka et son roman apocalyptique « La métamorphose ». On s’y retrouve donc la peau de Grégor, le jeune personnage transformé en un monstrueux insecte, condamné à l’immobilisme et à tout jamais étranger à son monde d’avant. Est-ce là désormais notre destin ?
S’estimer dépendant d’une « zone critique », cette biosphère si mince, si fragile, est sans doute le gage d’une salutaire prise de conscience. De même que considérer l’abyssal décalage entre le monde où l’on vit (celui où l’on a nos libertés) et le monde dont on vit (celui dont on tire nos ressources) qui peut aboutir à autre chose que la situation de désorientation générale dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
On assiste aujourd’hui à une redéfinition accélérée de la vie en société, à la fois catastrophique et passionnante. Est-ce à dire que des modifications rapides, profondes et globales sont désormais possibles ?
Si nous persistons dans ce postulat de « moderne », alors nous reprendrons l’avion pour un week-end à Istanbul, nous réserverons croisière de luxe pour un débarquement en nombre place Saint-Marc à Venise l’espace de quelques heures, nous persisterons à ne définir nos objectifs que quantitativement : 80 millions de touristes étrangers en France, 90 millions, 100 millions…
Ce travail d’enquête, d’autodescription que Bruno Latour a imaginé, ne peut-on pas le généraliser à titre personnel ? « Un peuple capable de se décrire peut établir un nouveau projet politique. » Chacun a la possibilité, à son échelle, de le mener avec son entourage, qu’il soit familial ou professionnel. Ce questionnement vise à se demander ce que l’on souhaite garder et ce que l’on veut changer en partant de sa propre vie, de son propre vécu. Et pourquoi ne pas l’expérimenter à l’échelle d’une filière, en l’occurrence la nôtre ? Bruno Latour l’avait, un instant, évoqué. « Prenons un exemple : à propos des activités à arrêter, on peut supposer qu’une réponse fréquente sera qu’il faut limiter le tourisme dit ‘de masse’. D’accord, mais que va-t-on faire avec tous les salariés de ce secteur ? »
Être « terrestre », ce serait donc redonner sens à notre filière et repenser le concept même de vacances ; s’interroger sur la notion primordiale d’habitabilité et donc requestionner le partage même de cet espace.
Que retenir, au final, de l’enseignement de Bruno Latour ? Ne jamais simplifier le réel. Ne pas hésiter à bazarder les modèles établis. Réinventer, toujours. Non pas innover, poncif de ladite modernité, mais transformer plutôt. Ecrire sur ses dépendances et ses menaces. Ah oui, de la méthode. Et du terrain, du terrain, du terrain…
Dans la même série : lire les autres articles de cette revue littéraire.
Références
- (1) « Habiter la terre – Entretiens de Bruno Latour avec Nicolas Truonc » (Les Liens qui libèrent et Arte Editions)
- (2) Précipitez-vous sur « L’arbre monde » (10/18), roman couronné par le Prix Pulitzer en 2019
- (3) « La Terre est un être vivant. L’hypothèse Gaïa » de James Lovelock (Flammarion)
- (4) Libération (10 octobre 2022)
- (5) « Tous centaures, éloge de l’hybridation » de Gabrielle Halpern (Le Pommier)
- (6) « Où atterrir ? Comment s’orienter en politique » de Bruno Latour (La Découverte)
- (7) « Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres » de Bruno Latour (Les empêcheurs de tourner en rond »)

